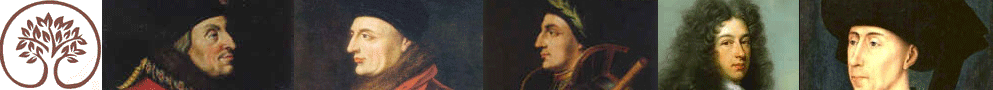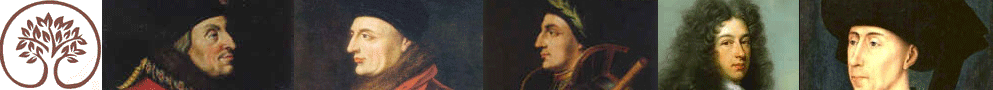FAUVERNEY
D’après un manuscrit de 10 feuilles numérotées de 91 à
100
Reprenant deux articles écrit par Clément-Janin et parus
dans Le Progrès de la Côte d’Or les 23 et 30 Juin 1884.
L’un
des plus joli village du canton de Genlis est certainement le village de Fauverney.
Bâti en amphithéâtre sur un petit mamelon, il domine toute la plaine, aussi
bien celle de Rouvres que celle de Magny. L’Ouche roule à ses pieds des eaux
claires qui font babiller un moulin. Les habitations, cachées dans des bouquets
d’arbres, émergeant des vignes, sont pittoresques, malgré leur simplicité, l’aisance
y règne, et même un brun de coquetterie ; presque à toutes les fenêtres,
on voit des fleurs.
Sauf l’église, rien d’ancien à Fauverney.
Le passé n’y a point laissé de traces apparentes. On dirait un village né
d’hier et sur lequel l’adversité n’a pas encore appuyé la main. Voyons si
l’histoire ne donnera pas quelques démentis à cette prospérité, et si les
jours ont toujours coulé heureux et calmes pour le village.
L’antiquité de Fauverney est certaine.
A défaut d’autres preuves, sa situation suffirait pour l’attester. Nos frères
choisissaient de préférence les endroits élevés pour y construire leurs habitations.
Mais ici, nous avons d’autres indices. Les vases de terre et de verre trouvés
par M. Brun, ingénieur, en 1839, la boucle d’or mérovingienne recueillie dans
la vigne de M. Philibert Couturier, et qui fait partie du cabinet de M. Baudot ;
le cercueil de pierre déterré près de l’église en 1854 et qui git encore dans
les hautes herbes du cimetière, enfin les trouvailles faites par M. Tabourin
dans sa propriété, à l’angle de la rue Madeleine et de la route d’Auxonne,
ne laisse point de prise au doute.
La voie romaine de Dijon à St Jean de Losne
passait à Fauverney. Dans le clos Tabourin, elle fléchissait au sud, coupait
les rues actuelles de la Liberté et d’Aval, traversait l’Ouche derrière la
Digue, séparait les meix de Bar et Favotte, puis se dirigeait sur Tart. Dans
sa vigne, M. Tabourin a trouvé un fragment de cette voie. A côté, on rencontre
de nombreuses sépultures et des armes. Un beau fer de lance, découvert en
Décembre 1882 et déposé au musée des Antiquités, appartient à l’époque mérovingienne.
Cela permet de croire que les armes recueillies dans la même propriété en
1840 et en 1869 appartenaient également à des sépultures barbares.
Une castramétation romaine s’élevait sur
la hauteur occupée par l’église, et protégeait les habitations groupées à
ses pieds. Les invasions barbares ruinèrent Fauverney, mais ne le dépeuplèrent
pas entièrement. Les traditions de la commune romaine y survécurent tellement
que le village compta toujours parmi les localités franches.
En 1282, Jean de Malon était maire de Fauverney.
Le mot maire, ici, doit être pris dans le sens de procureur des habitants.
Le maire figure à la suite du seigneur dans tous les actes où la communauté
intervient pour défendre ses intérêts. D’après Coutépée, Vulfe, patriée de
Bourgogne, fut assassiné à Fauverney, en 607 par les ordres de Brunehaut.
La vieille reine vengeait ainsi la mort de son favori Protade. Mille
dans son Abrégé Chronologique de l’histoire de Bourgogne, dit que cet assassinat
eu lieu à Faverney en Franche-Comté, et dom Plancher n’indique pas la province.
Je ne trancherai pas cette question difficile.
Au 11ème siècle, Fauverney appartenait à
la maison de Mailly. Garnier de Mailly, abbé de St Etienne de Dijon, y fit
construire vers 1045, une église sur l’emplacement même du Castrum romain.
C’est l’église actuelle, mais tellement réparée et restaurée, qu’il ne reste
plus probablement une pierre de l’édifice primitif. Etienne, seigneur de Fauverney
acheva l’édifice commencé par son oncle. Un siècle et demi plus tard, en 1188,
Manassés évêque de Langres « satisfait des services rendus par les chanoines
de St Etienne », unit la cure de Fauverney à leur abbaye. Il y mit une
condition : c’est que l’abbé établirait à Fauverney une communauté de
quatre chanoines pour en desservir l’église, ainsi que celle de Magny sur
Tille. L’évêque ordonna et le Duc de Bourgogne paya. Au dire de l’abbé Mathieu,
ce fut Eude qui établit le prieuré de Fauverney en 1191.
Courtépée ajoute : « dans un emplacement
près des fossés de son château dont-il affranchit le terrain en 1200. »
De quel château parle l’historien ? Il semble que c’est la butte de l’église,
et dans ce cas, les fossés son imaginaires. D’autre part, notre bon historien
dit que l’église, commencée en 1045, fut achevée par Etienne, seigneur de
Fauverney en 1188. Or, cet Etienne, comme on l’a vu plus haut, était neveu
de Garnier de Mailly. Courtépée le fait donc vivre 143 ans après son oncle.
C’est à rendre jaloux Mathusalem lui-même !
Le prieuré était situé entre les chemins
de Rouvres et du moulin. On le désignait aussi sous le nom d’ancienne cure.
Les bâtiments ont été démolis en 1860. Quoique les noms des seigneurs de Fauverney
soient peu intéressant à connaître, je vais mentionné brièvement ceux que
j’ai rencontrés. Le plus ancien est Garnier de Mailly, en 1045 ; Etienne
de Fauverney, en 1060 ; Humbert et Théodoric de Fauverney, en 1120 ;
Himbert, en 1125 (peut-être le même qu’Humbert) ; Etienne , son fils,
en 1132 ; Viard, en 1170 ; Guillaume, en 1187 ; Gauthier, en
1282 ; Robert, dit Montenois, en 1282 ; Guyot, en 1344. Par lettres
de Janvier 1230, Hugues donne son fief à Gauthier, seigneur de Fauverney,
tout ce que ce seigneur y possédait, moyennant une somme de 200 livres Provins.
Il lui permet, en outre, de bâtir une forteresse à Fauverney, « où il
le jugera à propos » laquelle lui sera rendable et jurable. Il ne
paraît pas que Gauthier ait usé de la permission ducale.
Les moulins de Fauverney sont très anciens.
Au 13ème siècle, ils appartenaient à ce Gauthier dont je viens
de parler. En Juin 1274, ses enfants, Guillaume et Guillemette les vendirent
au duc Robert, moyennant 800 livres viennoises, ainsi «que les sauveurs (viviers
ou réservoirs) étant au côté desdits moulins ; ensemble les biés, fonds,
closure, siège et pêcherie ». Parmi les pièces de terre, je remarque
« quatre journaux entre deux eaux » qui sont, si je ne me trompe,
désignés plus tard sous les noms de Meix de Bar et Favotte.
Quelques années après, en 1282, la duchesse
Agnès arrondi son domaine de Fauverney. Elle acheta tous les meix et terres
avoisinant le moulin, les uns pour 25 livres tournois, les autres pour 100
sols viennois. Il est parlé dans les actes d’une maison Poinsot de Blaisy,
et d’un meix Poinsot d’Arceau, qu’il ne serait pas impossible de retrouver
si l’on avait un amour immodéré du parchemin et des vielles écritures.
Mais aller donc perdre plusieurs jours de
votre jeunesse à chercher ces aiguilles dans des bottes de paperasses !
Les templiers étaient établis à Fauverney
dès le 12ème siècle. Comment ? je l’ignore. Il y avaient à
l’ouest du village une maison et une chapelle modeste qui ne demandaient qu’à
s’agrandir. Parmi les Templiers de Fauverney, on trouve frère Paris, de Bure,
reçu en 1271, et frère Etienne, reçu en 1291. Ce dernier figure dans le grand
procès des Templiers, en 1309. Il était alors agé de 72 ans. Interrogé, dit
Laviotte, relativement à l’aumône et à l’hospitalité, il répondit « que
dans les maisons du temple où il avait demeuré, l’aumône suivant la coutume,
était restreinte à trois fois par semaine, et qu’on n’accordait pas l’hospitalité
aux pauvres, ni à coucher, mais bien aux riches … »N’est-il pas
charmant, cet aveu de frère Etienne ?
Le duc Eudes III fut généreux pour les Templiers.
En 1208, il leur donna le moulin Gatin, sur la rivière de Crimolois, et la
basse justice sur tout ce qui lui appartenait dans le finage. Laissez leur
mettre un pied chez vous… dit le fabuliste. Par un échange avec Robert , daté
de 1293, ils devinrent seigneurs d’une grande partie du territoire de notre
village. Après la suppression de l’ordre du Temple leurs propriétés de Fauverney
allèrent à la Commanderie de la madeleine de Dijon, comme l’eau va à la rivière.
Pendant que les Templiers se désintéressaient
ainsi des bien de ce monde, un siècle avait passé et d’autres seigneurs prenaient
racine à Fauverney. Parmi eux est un certain Guillaume Docey ou d’Auxey, qui,
le 3 Septembre 1359 amodié à Jehan Géliot une noherie (noue) dite la noherie
Guillemin Docey, située « dessous la vigne du mostier ». Cela prouve
clairement que dès le milieu du 14ème siècle, il y avait comme
aujourd’hui une vigne sur le flanc du monticule de l’église, et que les fossés
creusés par Courtépée, n’existaient que dans son imagination.
Ce Guillemin Docey était un « argonier ».
En 1366, il prétendit avoir droit en la justice de La Vau ; on appela
des témoins, entre Jean le Puex, de Varanges, âgé de 60 ans, lequel donna
tord à Docey, au profit des prévost de Rouvres, c’est à dire au profit du
Duc. Il fut établi que les prévost tenaient leurs jours au lieu de La Vau,
sous l’orme, et déclaraient que « nul ne fut si hardi de moissonner,
si ce n’était de leur licence ». Om amendait de sept livres les contrevenants.
Les biens de Guillaume d’Auxey passèrent
à Jean de Villiers et à Guillaume Blonde. Ce dernier, en 1395, obligea un
habitant de Fauverney à démolir un petit four qu’il avait fait construire
dans sa maison, « en la partie que l’on dit La Vau ». Ce petit four
portait préjudice au four banal que Guillaume Blonde avait à l’Aval. De ce
qui précède, il paraît résulter que le quartier d’Aval était plus peuplé qu’il
ne l’est aujourd’hui. Les rats du Temple et de la Madeleine s’étaient mis
à l’aise dans leur fromage de Fauverney;
Ce
bien-être en attira d’autres. Le 16 Février 1391, Jean de Villiers, écuyer
seigneur de Layer, vend au duc Philippe le Hardi pour et au profit des Chartreux
de Dijon, « tout ce qu’il a en la ville et finage de Fauverney, en bois,
cens, justice, qu’il avait acquis de Guillemin d’Auxey ».
De son côté, Guillaume Blonde, écuyer, sergent
d’armes du roi, cède au même duc, le 12 janvier 1394, toujours pour les Chartreux
de Dijon, « la rivière de Fauverney et le quart de la dîme de
Champainfroid qui lui venaient de Poinsot, sire de Chateauneuf, et de Guillemin
d’Auxey ». C’était un riche cadeau que Philippe faisait aux Chartreux.
Ils s’établirent donc à Fauverney, élevèrent une « motte », sans
doute fortifiée, dans leur meix (aujourd’hui à Mme Couturier), et grignotèrent
tranquillement les revenus que leur faisaient les pauvres travailleurs…
J’ai laissé Fauverney au seuil du 15ème
siècle, partagé entre le duc de Bourgogne, les hospitaliers de St Jean de
Jerusalem et les Chartreux de Dijon. Chacun d’eux tond, retond le vilain,
et tant pis s’il crie. Malgré cela, le peuple naît à l’existence. Bien petitement,
bien timidement. Ses droits, s’il a des droits sont si peu de chose !
les cerches des feux sont curieuses à consulter, parce qu’elles indiquent
non seulement le mouvement de la population et les influences exercées sur
elle par les grands évènements, mais encore la fortune des habitants. Ainsi,
la cerche de 1375 constate à Fauverney, 7 feux francs, 46 serfs, 28 misérables,
total 81 feux ou 405 habitants.
Certes, la prospérité du village n’était
pas grande. Ces feux serfs, c'est-à-dire n’ayant à invoquer ni coutume, ni
abonnement, ne pouvant empêcher le seigneur de les mettre à contribution comme
il l’entend, de les tailler à volonté pour parler le langage de l’époque ;
ces 46 feux ajoutés aux 28 misérables sont d’une tristesse navrante. C’étaient
les fruits de la guerre de cent ans.
Plus tard, les serfs disparaissent. Comment ?
Il n’est point besoin de le dire. La mort fait d’abord les moissons dans le
troupeaux d’êtres humains sans pain, sans asile. La cerche de 1431 donne à
Fauverney 9 feux solvables, 14 misérables, 31 pauvres ou mendiant, total 54
ou 270 habitants.
Dans l’espace de 56 ans, le village avait
dons perdu 135 habitants. Ce n’était pas une migration qui avait perdu ce
vide à Fauverney : le dépeuplement était presque général. Dans le même
laps de temps, Rouvres perdait 150 habitants ; les Tarts, 205 ;
Saulon la Chapelle, 110 ;Cessey sur Tille, 100 ; Genlis, 30 ;
Savouges, 20. Dieu protégeait la Bourgogne ! De son côté l’Ouche faisait
des siennes, et des réparations y devenaient urgentes. Pour ces réparations,
la prairie de Fauverney fut imposée pendant les années 1432, 1450 et 1463.
Malgré le règne pacifique de Philippe le
Bon, la population de Fauverney diminua encore. En 1469, on plus que 43 feux,
215 habitants. Par contre tous francs, abonnés du duc et des hospitaliers.
Ils ne payaient point de tailles, mais ils étaient tenus aux redevances affectées
sur leurs héritages, à deux corvées de bras et à une poule de coutume.
Cependant, ils ne pouvaient s’imposer sans
la permission du commandeur du Temple, nom que l’on continuait de donner au
supérieur des Hospitaliers. Le 16ème siècle allégea encore les
chaînes du village. La commune se fortifiait de plus en plus, devenait plus
sûres d’elle-même.
Manants, soit ! mais ils comptaient
déjà pour quelque chose. Le roi, désormais possesseur de Fauverney ne songe
plus qu’a en tirer le plus de revenus possible. En 1538, Guillaume Berbisey,
lieutenant particulier du bailli de Dijon, « acquiert » les moulins
banaux de Fauverney, le revenu de l’Aval, le quart de la justice avec les
Chartreux. Acquérir, dans ce cas, signifie inféoder, presque amodier.
Cette justice qui se transmet, se démembre,
s’inféode au gré de chaque propriétaire, ne peut-être un service rendu au
justiciable. Ce qu’ont en vue les acquéreurs, ce sont les profits à tirer
de leut droit de justice, ou plutôt de leur droit de lever les amendes ».
Les moulins banaux étaient aussi une excellente source de revenus. Par une
charte de 1272, Hugues V avait décidé que les habitants de Rouvres ne pourraient
moudre leurs grains qu’au moulin de Fauverney, et cette obligation dura jusqu’à
la Révolution. Au mois de Septembre 1781, les Rouvréens avaient encore soutenu
un procès, pour essayer d’avoir la liberté de choisir leur meunier. Ils l’avaient
naturellement perdu.
En 1553, Jean Morelet, procureur du roi,
reprend de fief les moulins banaux de Fauverney, avec Marc Fyot, moyennant
3.400 livres. Aux moulins étaient ajoutés le droit de messerie, la garde du
pré de l’Aval et le quart des exploits de justice. Des lettres patentes du
30 Juin 1597 accordent au sieur Faidot, fermier particulier des moulins, une
diminution sur sa ferme de 8 émines de blé, estimées 120 écus « à cause
des pertes qu’il avait souffertes durant les troubles de la Ligue ».
En 1598, on remet encore à Faidot 10 émines.
Parmi les traditions romaines de Fauverney,
figure la « manse » devenue le Meix au moyen-âge. Le paysan franc
payait le cens à raison de son meix. Lorsqu’en 1375, nous voyons 7 feux francs
dans le village, cela permet de supposer qu’il y existait alors 7 meix différents.
Les archives en désignent plusieurs, tels que les meix de Bar et Favotte,
en 1274 ; le meix Poinsot d’Arceau, en 1282 ; le meix des moulins,
à la même date ; le meix Pincegrive, en 1413 ; le meix au maire
de Brochon, « dans lequel il y a une motte », en 1423. Il appartenait
alors à Alix, fille de Jean Perron de Beaune, et femme de Bernard de Marey,
seigneur de Fontaine les Dijon.
J’ai dit que le meix des Chartreux, connu
aussi sous le nom de « la digue » était à madame Couturier. Les
meix de Bar et Favotte, séparés par la voie romaine, puis, au moyen-âge par
un chemin appelé « le pâquier de Bar », avaient appartenu à Gauthier
de Fauverney. Vendus en 1274 par les enfant de ce seigneur au duc Robert II,
ils restent dans le domaine ducal, puis dans le domaine royal jusqu’au 16
ème siècle. Un conseiller au parlement, Jérôme Tisserand les tenait en fief
en 1596.
D’après un titre du 9 juillet de cette même
année, il payait 20 sols de cens au roi. Moyennnant ces 20 sous, il avait
le droit de justice haute, moyenne et basse sur les meix de Bar et Favotte ;
en un mot, les juges nommés par Tisserand auraient pu, à la rigueur, prononcer
la peine du fouet, du carcan, de l’amende honorable, de la marque par le fer
rouge, du banissement et même de la mort contre les criminels pris dans ses
meix.
Avec une telle perspective, il est probable
que les pêcheurs de Fauverney laissaient en paix les truites du conseiller
au Parlement ! En 1686, les meix de Bar et Favotte appartenaient encore
à Françoise de la Mare, arrière-petite-fille de Jérôme Tisserand, mariée à
Bouhier, marquis de Versalière, président à mortier au parlement de Bourgogne.
A l’heure présente, M. Cunisset-Carnot est l’un des propriétaires des meix
de Gauthier de Fauverney, de Robert IIet de Jérôme Tisserand.
La peste sévit à Fauverney en 1576.
En 1636, Galas ravage la Bourgogne, y sème
la mort et l’incendie. La peste le précède et le suit. Elle apparaît dans
notre village le 5 Septembre et enlève Claude Faidey. « Mort de la contagion »,
dit le registre de catholicité. Du 1er Janvier au 5 Septembre,
il y avait eu trois décès à Fauverney ; mais à partir de ce jour, les
morts vont vites Le 7, Pierre Blandin ; le 8, Bénigne Arnouillet ;
le 10, la femme Faidey née Charanne ; le 11, Claude Morey ;
le 12, la mère Charanne ; le 13, Perenelle Charanne, Claude Blandin,
Antoinette femme de Claude Blandin ; le 23, la veuve Pierre Blandin,
Claude Tarnier, Claude Carrelet ; le 26, la veuve Claude Rey ; le
30, Michel Faidey et la veuve Gaulthier. Le 1 er octobre, Agnès Maleschal ;
le 3, Marguerite Cornemillot ; le 4 , les veuves Claude Roulot et Claude
Carrelet ; le 9, Jacques Marbeau et le fils Baudot sont enlevés par le
fléau.
Du 9 octobre au 11 novembre, les registres
sont muets, pourquoi ? Hélas ! cette époque funeste coïncide avec
les dévastations de Galas. Récapitulons : du 5 septembre au 9 octobre,
21 habitants morts de la peste à Fauverney ; il faut y ajouter 18 décès
en novembre et décembre : total 39 sans compter les malheureux moissonnés
pendant le mutisme des registres. La moyenne des morts à Fauverney de 1637
à 1640 n’est plus que de 4 à 5 par an.
En 1645, il restait seulement 81 habitants
imposés dans le village, dont 10 veuves. « Il n’y a que 20 personnes
qui se meslent de labourage, dit le procès-verbal de la visite des feux, aucun
desquels s’associent, n’ayant pas moïen de faire seule une cherrue. Ils sont
rentiers (fermiers) ; les autres habitans gaignent leur vie comme ils
peuvent, tous manouvriers ».
Pierre Pauthenier était recteur d’école
à Fauverney, en 1691. C’est le premier dont on retrouve le nom. Il est probable
que son école différait beaucoup de celle dirigée aujourd’hui avec tant d’intelligence
et de savoir par M. Gevrey. A la même époque deux chirurgiens habitaient Fauverney :
Jean Roustant, Claude Berthot. Ces chirurgiens là valaient à peu près les
maîtres d’écoles.
L’inondation de 1764 causa un grand trouble
dans notre village, en enlevant la planche « de 140 pieds de longueur
et 3 pieds et demi de largeur » qui permettait au curé de traverser l’Ouche
pour vaquer à son service. Dix ans plus tard, le curé Cordival demande qu’on
lui bâtisse un nouveau presbytère sur le cimetière « qui est très vaste »,
et que l’on vende l’ancien. Les habitants préfèrent réparer sa planche sur
l’ouche. Cette malheureuse planche fut encore enlevée au mois de février 1789,
et le curé ne pouvant plus passer l’eau, l’évêque de Dijon envoya un capucin
pour dire la messe à Fauverney.
Vers 1750, un violent incendie détruisit
toute les maisons de la rue Madeleine. Cette rue appartenait aux hospitaliers.
En 1788, trente cinq de ses habitants étaient de la justice de la Madeleine
et avaient le droit de pêche dans l’Ouche… excepté pourtant chez le haut et
puissant seigneur des meix de Bar et Favotte.
La révolution éclate et fait entendre son
cri de justice et de délivrance. Il a des échos à Fauverney. Les travailleurs
de la terre, ceux qui l’ont fécondée pendant tant de siècle, se relevant enfin,
voient s’évanouir les privilèges et les abus, comme la neige aux premiers
soleils. Domaine du roi, terres des Chartreux et des Hospitaliers, tout est
morcelé, déchiqueté, vendu au profit de la nation. Jacques Bonhomme, devenu
citoyen, va régler ses différends à la justice de paix de Rouvres. Pierre
Tarnier était maire de Fauverney en 1790 ; Jean Cornemillot, en 1792.
Le 11 avril 1793, le citoyen Pierre Dupré est proclamé volontaire de la commune
de Fauverney. Le 3 germinal, an II(23mai 1794) il y avait fête à Fauverney
pour la plantation de deux arbres de la Liberté.
Sur la proposition de Hugues Bartet, le
consul général de la commune décide à l’unanimité que l’inscription suivante
sera placée sur l’un de ces arbres : « Emblème sacré de la liberté,
arbre chéri, sois toujours le point de ralliement des bons citoyens et l’effroi
des ennemis de la Révolution. C’est sous ton ombrage que nous nous réunirons
pour célébrer les triomphes des armées de la République et chanter des hymnes
patriotiques. Pères et mères des braves défenseurs de la patrie, vos enfants
combattent en ce moment les satellites aveugles des despotes couronnés; puissent-ils
après les avoir tous exterminés dans le cours de cette campagne, revenir ici
pour y recevoir avec vos tendres embrassements, les palmes de la victoire
et les myrtes de l’amour ; que la plus belle soit le prix de celui qui
aura mérité le mieux de la patrie ! Vive la République une, indivisible
et démocratique ! Anathème aux ennemis de la Révolution ! »
Chargé d’une telle inscription, un arbre ne pouvait vivre longtemps. Il emporta
si bien en mourant les vœux du citoyen Bartet, que nul ne se rappela quand,
en 1848, on planta les deux arbres de la liberté qui ombragent encore la place
de la Mairie.
La République !.. on conspirait déjà
contre elle, au banquet donné sur l’emplacement de temple de Fauverney, en
1849, et son nom devait être sévèrement proscrit du village pendant vingt
ans. Les fils oubliaient les serments prononcés par leurs pères.
C’est en 1884, seulement, que la République
fut acclamée de nouveau à Fauverney. Un conseil républicain entra à la maison
commune, et choisi poour maire un homme aimé de tous, sans haines particulières,
sans passion que celle de la justice, lequel s’efforcera de faire oublier
les divisions d’autrefois.
Ah ! si l’on voulait comparer le village
d’aujourd’hui, libre, industrieux, prospère, avec le Fauverney du roi, des
Chartreux, des Hospitaliers, quel éloge feraient les plus aveugles des bienfaits
de la Révolution. Comme ils verraient qu’elle a semé le bien-être à pleines
mains Et si maintenant vous demandiez à l’un de ses habitants de quel
village il est ? Au lieu de l’humble, du timide d’autrefois, vous le
verriez se redresser fièrement, vous regarder en face, et l’ironie sur les
lèvres, vous l’entendriez répondre :
"Ma i seu de Fauvaneiy,
mon bel ozéà !"